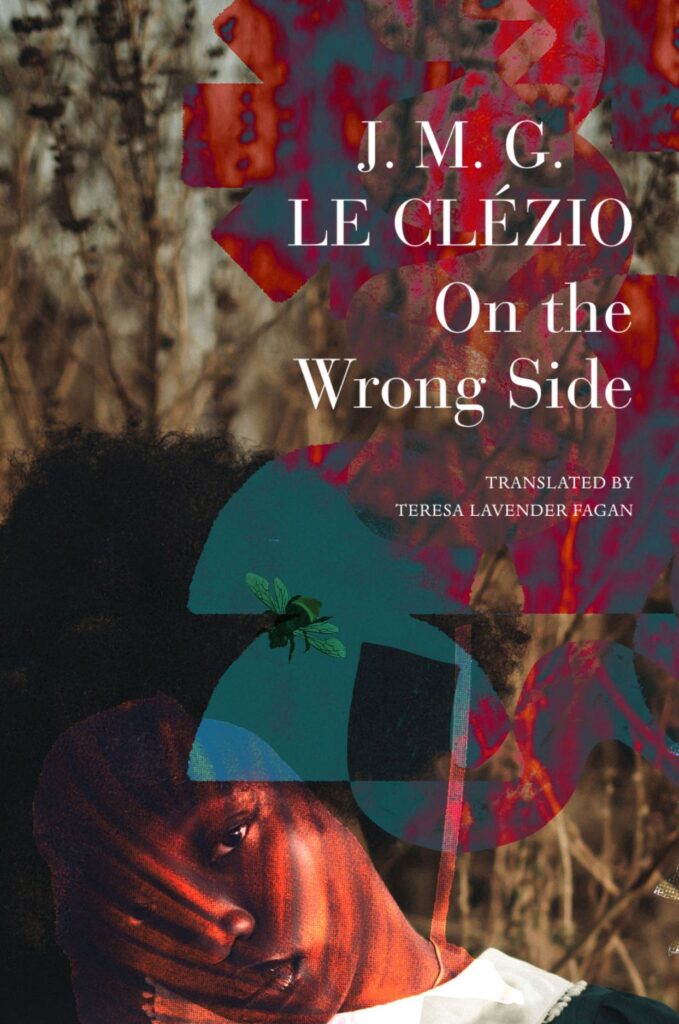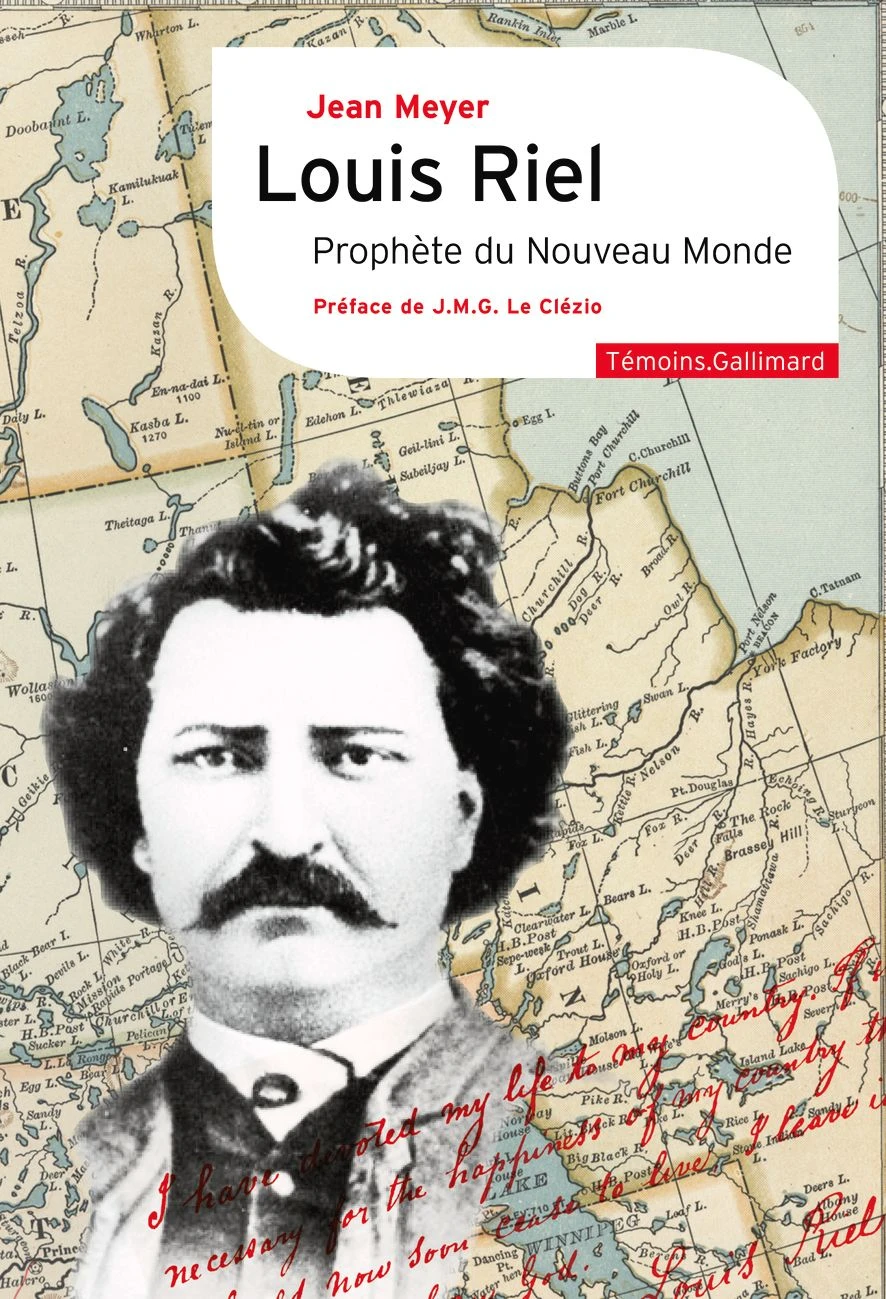Entre les feuilles, explorations de l’imaginaire botanique contemporain, de Rachel Bouvet, Stéphanie Posthumus, Jean-Pascal Bilodeau et Noémie Dubé, publié aux Presses de l’Université du Québec, collection « Approches de l’imaginaire », 2024.
« Tout comme il y a une « fabrique des corps désarmés », liée à la mise en place de l’État moderne et des systèmes coloniaux, il y a une fabrique des terres désarmées. Le désarmement de la nature, c’est la construction historique et politique de son impuissance. » Dénétem Touam Bona, Sagesse des lianes, cosmopoétique du refuge, 1, page 83.
Entre les feuilles… Dès le titre programmatique de cet ouvrage multiplumes consacré aux univers du végétal, un essentiel nous est livré : l’importance de l’entre, pour un livre à la croisée de l’observation botanique, de l’étude de textes littéraires, de deux approches géopoétique et écocritique se déployant depuis la mi-temps des années 90. C’est l’écart que nous avons en commun, écart pris au sens où l’entend François Jullien, qui ouvre l’éloge de la relation convoqué par cet entre. Il nous incite à penser que produire de l’entreest la condition pour promouvoir de l’autre, ce qui serait le premier gage d’une approche non anthropomorphique des végétaux. Si l’introduction de cet ouvrage rappelle quelques préjugés relatifs aux plantes (l’immobilité) et à la nature (binarité nature/culture qu’invite à repenser Descola), elle s’en éloigne vite pour circonscrire le champ très étudié depuis les années 2000 sous le nouveau paradigme de l’agentivité des plantes, des travaux de Francis Hallé à Emanuele Coccia, ou lors d’expositions comme Nous les arbres(Fondation Cartier, au titre certes anthropomorphique). C’est le medium du texte littéraire – et non scientifique – qui est cependant à l’honneur ici, pour explorer l’imaginaire botanique, selon six paramètres : intention, posture, spatialité, temporalité, techniques et mobilité (p. 13).
Une des originalités tient à la corrélation de la structure du livre rhizomique avec celle de la cartographie numérique qui fut le premier chantier de cette réflexion d’ampleur. Nous souhaitons d’emblée poser en exergue et écho liminaire l’essai Sagesse des lianes, cosmopoétique du refuge, 1, de Dénétem Touam Bona (Post-éditions, 2021) qui porte un même intérêt deleuzien et euristique au rhizome. Cet essai qui confère à la liane sa valeur opératoire pour une approche par le mouvement, la fugue euristique, pointe aussi l’imagerie coloniale liée à ce végétal avec ses avatars : le patriarcat et la propriété. Il s’agit d’appeler et de vivre ce mouvement mais encore de désintoxiquer les imaginaires en les réinventant et en les décryptant, de réfléchir à l’outil qu’est la carte et suivre des personnages marcheurs, qui pratiquent le lieu. L’essai annonce la liane au titre, l’ouvrage collectif l’aborde dans les dernières pages, notamment en citant Patrick Nottret, et tous deux relèvent la valeur refuge des forêts où se cacher, telle la pratique du marronage, et l’enchevêtrement qui abolit les frontières. De très belles pages d’Entre les feuilles différencient finement l’enchevêtrement de l’emmêlement (p. 261). À la lecture se dégagent des perspectives pour se tenir loin des prédations coloniales puis des lois du marché comme la forêt-refuge (terme de la législation québécoise, p. 216) ou les solidarités d’une communauté.
Une autre originalité tient à la genèse de l’ouvrage : la conception d’une cartographie mise en ligne depuis 2021 que nous invitons à explorer, invitation à votre propre mobilité de lecteur, navigant sur la toile, pour vous immerger dans les relations entre plantes et humains, entre plantes, choisissant parmi des entrées « plantes », « fonctions », « romans ». Ce support numérique cartographie les mobilités de plantes, choisies pour leur occurrence dans un corpus de récits. Cette photographie conservatoire contribue ainsi à la compréhension du patrimoine végétal, puisque se pose la question de la mémoire des lieux, d’un herbier pensé comme « catalogue du vivant » et « vestige de mondes disparus » (p. 57).
Dans cette continuité, l’essai offre une entrée par la botanique dans la mémoire de l’île plate de La Quarantaine de Jean-Marie Le Clézio, avec les importations de plantes, ou des gestes pour cultiver le maïs des Jésuites (Ourania) au passé trouble du jardin (ancienne caserne, réseau de prostitution). La métaphore végétale en dit long – « Les goyaves pourrissaient dans la terre » (Le Clézio, p. 224) – et évoque la nécessité de penser l’histoire des écosystèmes en relation avec l’histoire humaine, strate par strate. L’écrivain est alors un révélateur de traces, un archéologue des disparitions, ainsi dans Raga où ouvrir « des chemins neufs, en frissonnant de crainte, entre les tombeaux des anciens disparus. » (p. 115) Si les autrices et auteur insistent sur la dimension sacrée, elle concerne cependant plutôt la fécondité : rituels magiques pour semer des graines, conception d’une terre-mère, jardins semés « selon un plan qui doit ressembler à la magie. » (Le Clézio, p. 70)
Notre fil rouge de lectrice sera de nous concentrer sur les lectures d’un récit de voyage autobiographique et de deux romans au personnage voyageur de Jean-Marie Le Clézio, ce qui rejoint le geste du livre d’aborder quatre figures : l’herbier avec les personnages du botaniste et de la guérisseuse dans La Quarantaine (1995), le jardin pour la forêt-jardin dans Raga : approche du continent invisible (2006) – qui renvoie donc aussi à la forêt – et le champ avec les pages consacrées aux fraises et enfants du Mexique dans Ourania (2006). L’arbre est l’absent de l’ouvrage comme indiqué page 287. Nous notons que le jardin, notamment avec ses légumes-racines est présent dans les trois livres du corpus leclézien. Et parmi les portraits de neuf plantes essaimés dans l’ouvrage, (caféier, orchidée, igname, rosier, pomme de terre, canne à sucre, figuier, ortie, fougère), relevons la canne à sucre qui sert la critique de Jean-Marie Le Clézio de la colonisation dans ses modes de prédations du sol, d’exploitation et d’épuisement par des monocultures intensives, et l’igname à la dimension sociale soulignée dans Raga. Et si vous êtes en quête de cocotiers (« reliquats de la colonisation », écrit Le Clézio) rendez-vous sur la cartographie virtuelle, c’est la dixième plante bonus. Jean-Marie Le Clézio l’évoque dans son cycle indianocéanique. Au prisme des plantes, l’essai épingle l’exotisme, salue la difficulté de traduire un nom vernaculaire de plante (avec cette idée très originale d’une résistance à la traduction, p. 28). La question de la diversité, dès la nomination vernaculaire, est prise en charge par la constitution des banques de graines, patrimoine protégé par un Pierre Rabhi ou reconstitué par une Vandana Shiva. Cet éloge de la variété des plantes, de la biodiversité concerne aussi les humains à Campos (Ourania, p. 209), dans une pensée inclusive dans le monde du vivant inter-espèces. Nul doute que Jean-Marie Le Clézio accorde une place à la question coloniale, aux êtres humains qui la subissent, comme à la terre, l’environnement qui en est altéré, et cela dès l’écriture du Rêve mexicain, récit de la rupture écouménale provoquée par le génocide des Autochtones. À tous les niveaux, – végétal, humain et narratif –, l’entrelacs et la diversité sont des dynamiques à l’œuvre, fécondes.
Nous pourrions décliner la poétique de la liste, dans Ourania (même pour les fraises, une liste des variétés de fraises où dénotent les noms donnés comme Dollar !), en un long poème : brèdes malbar, bevilacqua (La Quarantaine) etc. Pour Raga rendez-vous en fin du parcours de la cartographie littéraire des plantes consacrée en 2019 exclusivement à ce récit par le même groupe de recherche.
L’essai questionne tant l’échelle (de l’herbe au microscope à la carte planétaire pour voir le déplacement) que le sensible, mais ce qui domine est, d’une part, la vertu du mouvement, du désir, que ce soit dans la migration, mobilité et plus finement dans la manière d’habiter le monde : ménager, bâtir en cultivant (Martin Heidegger), pour un habiter actif (Olivier Lazzarotti). Et, d’autre part, les effets produits par les plantes sur le récit qui se mesurent au rythme alenti harmonisé à celui des plantes, ou à la délinéarisation du récit sous l’effet d’un écosystème impénétrable. L’effet joue sur l’ouvrage-même ; Entre les feuilles file l’entrelacs facile à suivre grâce à une structure bien solide et campée. Vous apprendrez qu’une jungle met 700 ans à se régénérer (p. 251), vous apprendrez bien d’autres choses encore, vue la richesse de l’ouvrage, d’une lecture néanmoins très fluide.
Les analyses du récit leclézien épinglent un savoir enclos, l’obsession en « vase clos » du scientifique John Metcalfe avec ses réflexes méthodiques d’arpentage, de classification, sa passion du savoir – mais aussi des savoirs quand il retient la variation créole d’une plante et non exclusivement la nomination latine –, de notes fragmentaires dans son carnet, sa volonté de trouver l’indigotier sauvage auquel donner son nom, en toute vanité (La Quarantaine). L’essai note que « La dénonciation de certains travers de la civilisation occidentale va souvent de pair avec une valorisation de savoirs autres, traditionnels, émanant de civilisations ayant longtemps été conçues comme inférieures. » (p. 65) La guérisseuse Ananta, qui connait les vertus de la bevilacqua, est donc une sorte de pendant au botaniste et une figure du care. Nous aimerions aouter que se profile aussi une binarité homme/femme : botaniste découvreur et épouse secrétaire de ses fiches, botaniste rationnel et guérisseuse. L’essai insiste sur l’opposition entre les Européens blancs qui ne se mêlent pas aux coolies indiens, cultivant les jardins vivriers. Il faut alors une figure de lien, Léon amoureux de Surya, qui l’initie à la cueillette (ce qui nous rappelle une autre initiatrice, Ouma dans Le Chercheur d’or). Le végétal nourricier ou médicinal est associé au féminin (Ananta, Surya), ce qui renforce la perception d’un care au féminin. La figure du couple chez Le Clézio s’épanouit dans Raga (l’essai ne rappelle pas un autre couple illégitime mythique lié au végétal) et dans Ourania, où s’associent dans leur métissage, le savoir de Sangor, un médecin, et de sa compagne Marikouan, une Autochtone. Le jardin devient le lieu d’une revisitation dans le récit plus que de la clôture d’un espace, par ailleurs signalée davantage par les barrières mentales des Européens que par un tracé physique. Les grandes cultures n’existent pas sur Raga, ce qui encourage l’« impression d’une nature retournée à l’état sauvage ». Cette absence de clôtures conduit Le Clézio à écrire « Aujourd’hui, Raga est un jardin ». Dans Ourania la valeur sauvage d’une plante serait symbolique de liberté : « Nurhité est sauvage, on ne peut pas la planter ni la semer. Elle pousse librement, là où elle veut, sinon elle meurt » (passage cité p. 208)
Ce compte-rendu, focus sur la trentaine de pages sur 300 qui analyse la présence végétale (avec la multitude de ses usages médicinaux, culinaires et textiles – sac en vacoa) dans les récits de Le Clézio, pourrait susciter l’envie de découvrir les 27 autres récits étudiés ! Quelques amorces ? Quel lien entre le café et l’alchimie ? Quel est le don des fleurs chez Mona Thomas ? Qui écrit un manifeste des ivraies ? Et qui d’autre les nomme « vagabondes » ? Quel livre, autour des mangroves, n’entrelace pas moins de 19 voix de personnages ? Et vous, à quel roman-rhizome convoquant le végétal, pensez-vous ?
Le lecteur appréciera sans doute une inclinaison à la confiance plus il avance dans la lecture. Sont ainsi abordées des pratiques en dormance, comme le sont les graines (p 192), des modes de préservation et de résistance sans visée utopique pour ralentir la dégradation, à défaut de la stopper. Et surtout prend le pas le paradigme du faire avec plutôt que du faire, dans la production afin de respecter le cycle végétal, le tout pour restaurer une relation écouménale. Nous remarquons que la temporalité suspendue (en quarantaine), ne résiste pas à la mort, celle propre à une utopie (le village Campos) ne résiste pas à la logique d’exploitation, par voie d’expulsion (Ourania) quand celle mythique (Raga) ouvre à l’émancipation des femmes de Raga grâce à leur artisanat textile, précisément. La temporalité est toujours aux prises avec la conscience de strates et l’alternative entre disparition/survivance. Et c’est alors que la disparition fait place à que ce que nous pourrions appeler une revivance : faire revivre des « espèces disparues » (p. 197), des connaissances ancestrales (p. 212).
Cet ouvrage, doté de son appareil critique est aussi un hymne au récit. Par des actes de lecture dans la diègèse, le carnet du botaniste (La Quarantaine), les cahiers du jeune métis Raphael Zacharie (Ourania) lus par le géographe, et plus encore par le discours de ce même Daniel Sillitoe lors de sa conférence au centre de recherche qui quitte le jargon du métier pour « raconter » (p. 182) la naissance de leur pays aux habitants présents et à qui il adresse au final son discours. Et par le lecteur des récits de Le Clézio, stimulé par le parcours d’Entre les feuilles : quel lecteur d’entre vous poursuivra ce chemin de penser en relisant autrement Angoli Mala, Voyage au pays des arbres, « Mondo » (et le jardin de Thi Chin) pour questionner les enjeux territoriaux et environnementaux ? Quel fin lecteur des récits de Le Clézio n’aurait pas envie de pister les occurrences d’une eulalie, de se prendre au jeu de piste botanique à la lettre ?
En somme, l’essai pose la littérature et ses imaginaires comme auxiliaire d’un changement de paradigme qui peut transformer notre regard sur les plantes. « Parce qu’il permet de partager une expérience sensible du végétal et de décliner les multiples rapports possibles avec les plantes, le texte littéraire offre à cet égard un plus large spectre que le discours scientifique, soumis à des exigences d’objectivité et de rigueur qui le surdéterminent. » (p. 285) Cet essai à plusieurs mains a foi dans la capacité des récits à nourrir et modifier nos imaginaires, pour que nos représentations et notre perception du végétal se métamorphosent, et vivent leur agentivité. Ainsi l’ouvrage consacre-t-il le récit comme possible ensemencement.
Isabelle Roussel-Gillet, 11 juillet 2024